|
La perception du handicap Intervention à la Biennale HANDI-INSERTION
|
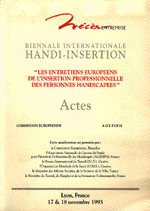 |
Dans le cadre de la réflexion qui est menée à cette Biennale HANDI-INSERTION, nous allons tenter d'apporter une contribution au sujet qui nous intéresse ici : "La perception du handicap". Pour ce faire, nous en détaillerons le mécanisme et nous ferons un premier exposé de ce que des recherches antérieures nous ont apprises. Nous commencerons par faire un constat que vous me permettrez de tirer de ma propre expérience.
A la suite de l'événement traumatique qui me jeta hors de la norme, je fus classé par l'organisme de protection sociale dont je dépendait, dans la catégorie des "invalides incapables d'exercer une profession quelconque". L'hôpital psychiatrique qui m'employait, lui, me fit savoir que "mon contrat était rompu pour cause d'inaptitude à la fonction" et me versa une rente. À aucun moment cette institution n'a envisagé un maintien dans l'emploi. Si une certaine part de mon travail de soins me devenait effectivement inaccessible, mon état physique ne m'interdisait pourtant de chercher à faciliter, à défaut d'améliorer, les moyens d'une communication entre soignés et soignants. Cette perte d'emploi liée à mon état physique et la reconnaissance d'une "inaptitude à exercer une profession quelconque", furent les deux éléments que le système social m'offrit comme capital de départ. Je cherche depuis à comprendre la "folie" d'un système qui, tout en exprimant un désir de faciliter mon insertion professionnelle, me reconnaît dans le même temps incapable d'exercer un emploi. On peut aussi se demander de quelle "schizophrénie" sont atteintes les institutions qui, avec l'objectif d'une meilleure intégration sociale des personnes qu'elles soignent, excluent dans un même temps ceux de ses salariés qui deviennent différents. Il est facile de remarquer d'autres écarts entre le désir exprimé d'intégration des personnes handicapées et la concrétisation de celui-ci, entre les recommandations légales et l'application effective de ces dernières : dans la législation, les comportements individuels, comme dans un grand nombre des relations qu'entretient la société avec les personnes handicapées.
De la perception, le Grand Larousse nous dit qu'elle est "un événement cognitif dans lequel un stimulus ou un objet présent dans l'environnement immédiat d'un individu, lui est représenté dans son activité psychique interne, en principe de façon consciente. Une fois que l'information visuelle, auditive, olfactive, etc, a été recueillie, d'autres processus interviennent pour la traiter par suppression, ou filtrage, par adjonction, par transformation, par interprétation ; c'est à la suite de ce traitement que se trouve construite une représentation interne du stimulus ou de l'objet."
La perception correspondrai à une excitation du psychisme. Nous la situerons comme la seconde étape du processus destiné à élaborer une réponse adaptée au stimulus. Pour plus de clarté, nous décomposerons ce mouvement, que nous nommerons processus de réponse, à la chaîne de mécanismes suivante :
Le terme de construction est utilisé ici pour nommer le traitement de la perception par les éléments de la mémoire consciente, inconsciente, individuelle et collective. Le résultat de cette "cuisine" - la représentation -, sera aussi influencé par les variations du cadre, physique, social, culturel et temporel de la perception.
Nous ne rapporterons ici que ce que nous avons appris de la mémoire individuelle inconsciente et de son influence sur la construction de la représentation.
La tendance à l'exclusion de l'infirme est un mouvement universellement répandu, quelque soit les sociétés ou l'âge de l'humanité. La gène et le malaise qui parasitent souvent les relations avec les personnes handicapées, sont déclenchées à l'apparition des déformations, mutilations ou castrations symboliques qui rendent problématiques, voir impossibles, les mouvements d'identifications en jeu dans la relation.
La mutilation visible de l'autre provoque une blessure qui pourrait s'exprimer comme le cri de Narcisse face à son image soudain déformée : "je ne te/me reconnais pas, tu m'est trop différent pour satisfaire mon amour du même".
L'élément de la mémoire ici en jeu, va influencer plus ou moins le déroulement de la construction en fonction de l'histoire personnelle de chaque individu ; c'est la résolution des problématiques inconscientes qui est là en cause.
D'autres éléments et d'autres niveaux de la mémoire peuvent bien évidemment interférer sur le déroulement de ce processus, la connaissance d'un proche handicapé ou le vécu antérieur d'une situation de dépendance pouvant, par exemple, faciliter la construction d'une représentation plus conforme à la réalité. Influencé aussi par des éléments situationnels, ce traitement est donc comparable à une alchimie dont il serait aussi ambitieux de vouloir détailler ici les éléments, qu'il le serait de vouloir décrire le monde en quelques pages.
Nous pouvons toutefois, dans un essai de synthèse, décrire ce mécanisme de construction comme générateur d'une représentation "malsaine", dérangeante parce qu'associée aux angoisses profondes, aux peurs infantiles et aux tabous ancestraux dont nous sommes tous porteurs. Cette régression dans les sentiments et ce retour du refoulé, provoquent un fort sentiment de culpabilité et un désir de réparation. Une émotion plus ou moins forte surgit et les capacités d'analyse sont réduites d'autant ; c'est là où la réaction prend le pas sur l'action.
Les textes de loi qui visent à faciliter l'insertion des personnes handicapées sont ainsi adoptés à une unanimité rarement atteinte par d'autres, même s'ils sont inapplicables et difficilement appliqués. La première loi d'obligation d'emploi d'un quota de 10 % de personnes handicapées, de guerre à l'époque, dans les entreprises de plus de 20 salariés date de 1924 ! Nous sommes en 1993, l'obligation est passée à 6%, des "bonus" interviennent, et le quota réel des personnes handicapés intégrées en entreprise est de 3,6 %. Nous nous approchons d'une loi adaptée à la réalité, applicable et appliquée. Ceci nous honore, et nous atteindrons encore mieux notre objectif d'une société pour tous, si nous reconnaissons qu'une part inconsciente de nous même refuse la proximité de l'infirme.
Souvenons nous qu'en des temps anciens on tuait l'infirme, qu'en des temps pas si anciens on l'enfermait, et acceptons de voir que certains animaux l'agressent et le chassent de la meute. Ce mouvement de rejet, d'exclusion, est donc, sinon naturel, commun à de nombreuses organisations sociales et inscrit au fond du vivant. C'est en reconnaissant en nous la présence de cette tendance enfouie que nous pourrons mieux la maîtriser, et c'est en apprenant à la dompter que nous pourrons mieux l'intégrer à notre raisonnement conscient.
Nous ne nous débarrasserons pas de ces vieilles craintes à seuls coups de subventions et nous ne résoudrons pas en un siècle une exclusion millénaire. Accepter de vivre continûment avec les personnes handicapées, c'est aussi apprendre à maîtriser ses craintes et accepter de faire un travail sur soi ; et c'est peut être ici la plus haute marche que nous aurons tous à franchir pour atteindre les objectifs d'intégration des personnes handicapées qui sont exprimés ici. Débarrassés de la culpabilité et du désir de réparation, nous pourrons ainsi, pour la première fois dans l'histoire, ne plus parler des handicapées, invalides ou des exclus, mais simplement de femmes et d'hommes dont les contraintes et les besoins sont différents des nôtres et le désir de vivre le même.
 Sommaire
interventions
Sommaire
interventions