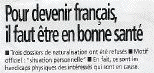
Notes :
1 : J.-C. Sailly, T. Lebrun et J.-P. Marissal, "Le Point Carré" N°111, Octobre 1994.
2 : Centre National des Arts et Métiers, Paris.
3 : Classification Internationale des handicaps, "World Health Organisation, 1980, Trad. CTNERHI-INSERM, 1988, Diff. PUF.
4 : Je dois ici remercier le Professeur Michel FARDEAU et son équipe du CNAM pour leur enseignement dans le cadre du Laboratoir B. FRYBOURG.
5 : INFO MATIN N°200 du 20 Octobre 1994
6 : A. Bardot, M. Maury, L. Arné, "Le Point Carré" N°111, Octobre 1994.
|
Que coût il y ait et qu'il soit nécessaire d'en évaluer le montant, je n'en doute point, mais tout bon bilan se doit de prendre en juste considération les bénéfices aussi bien que les déficits. "Les bons comptes font les bons amis" dit l'expression populaire.
|
Publié par Témoignage Chrétien du 16 décembre 1994 Le Point Carré, N° 113, Mars 1995 ðRéadaptation, N° 418, Mars 1995 |
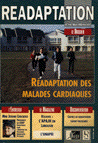
|
Les questions sont : combien ça coûte ? et peut-on y faire face ? Le raisonnement économique se veut détaché de toute considération d'ordre affectif, tout se déroule comme un savant problème de mathématique et suivant une vision "fonctionariste" de la gestion sociale qui donne froid dans le dos.
Une autre communication du même acabit me fit réagir en public récemment, au colloque "Handicap et développement", une des manifestations du 200 ème anniversaire du CNAM (2). Une partie des interventions s'est attachée à évaluer le coût économique du handicap, les chiffres et les statistiques pleuvaient comme pour rassurer leurs auteurs. Ces derniers confessent pourtant leurs difficultés, ils font le même constat que font tous ceux qui cherchent sur la question : On manque de chiffre précis, on évalue mal et on ne sait pas vraiment.
Le premier problème est celui de la mise en chiffre des besoins d'une population dont on définit encore mal les contours, le second est celui de l'objet de la mesure ; on ne sait pas quoi mesurer exactement. Le handicap n'entre pas dans les chiffres et ne se met pas en équation, c'est la conclusion que je retiens et il n'est rien d'étonnant à cela ; comment mesurer une situation ? Le Professeur Philip Wood, dans son introduction de la Classification Internationale des Handicaps (3), apporte une notion fondamentale qui pourrait nous aider dans ce cheminement. Le postulat préalable de cette approche d'évaluation, s'attache à considérer le handicap comme la conséquence situationnelle d'une incapacité du fait d'une déficience physique, sensorielle ou mentale. Le désavantage qu'il s'agit d'évaluer, serait donc la conséquence d'éléments plus mesurables. Mais la notion de désavantage fait explicitement référence à une norme, "état normal", lui même défini par les moyennes et les idéaux des membres du groupe d'appartenance et qui, de surcroît, sont en constante évolution (4). Au delà du débat qui peut se mener sur la définition d'une norme ou d'un étalon de mesure, il peut être intéressant d'analyser la démarche de ces recherches. Elle est vaine à mon sens. L'approche économique actuelle fait appel à une motivation principale : Comment prendre en charge ? A l'opposé, ce qui nous importe, à nous "les charges", c'est avant tout de savoir comment il est possible de décider de notre propre vie, de travailler, de voyager, de rire, de partager et de vivre en meilleure harmonie possible avec nous même. Pour nous, la question est : Quelle est la meilleure façon de se prendre en charge ?
Comment soutenir et faciliter l'autonomie et la participation active des personnes handicapées ? Posée ainsi, la question de la prise en charge appelle à d'autres recherches économiques. Nos besoins spécifiques doivent êtres compensés par un certain nombre d'aides médicales, techniques ou humaines. Elles le doivent en raison du Droit du Citoyen et des Droits fondamentaux de l'être humain. Citoyens et pleinement conscients de nos devoirs envers la collectivité, nous demandons le droit à la libre circulation, à l'éducation, à la non discrimination et à l'ensemble des droits fondamentaux de la Déclaration Universelle. Depuis peu, dans nos sociétés occidentales, le progrès et la recherche médicale sont orientés par des choix et, si ce n'est par celle de nos rêves de toute puissance, de moins en moins guidés par la nécessité. Nous sommes confrontés à des frontières dont les débats éthiques et les recherches moralistes du moment montrent l'inquiétante étrangeté. Développer une médecine de plus en plus efficace est aussi un choix de société, et une conséquence de ce choix est paradoxalement une augmentation de la population handicapée, car mieux soignés, nous existons là où nous aurions péri il y a quelques années. Il est bon d'avoir le choix, il est mieux d'en assumer pleinement les conséquences.
Je suis inquiet et terrifié quand je découvre dans le journal du jour (5) , qu'un fonctionnaire de la sous-direction des Naturalisations dépendant de la Direction de la Population et des Migrations du Ministère des Affaires Etrangères, a refusé plusieurs demandes de naturalisations faites par des personnes handicapées. Sa réponse est digne des plus noires thèses de l'extrême droite : "Votre naturalisation serait de nature à entraîner une charge pour la collectivité".
Je m'élève en faux. Je découvre richesses et vérité depuis que je vis cet inquiétant "monde du handicap", depuis bientôt douze années. Souffrances, tortures intérieures, vide et désespoir bien sûr, au début surtout, mais ni plus ni moins que tout à chacun dans mon quotidien d'ici et maintenant. Richesse quand un transport devenu enfin accessible à nos fauteuils roulants facilite la vie de 25% des usagers des transports publics, de la mère avec son landau à la personne chargée de bagages, en passant par le sportif au pied cassé et en n'oubliant pas grand mère et le poids de son âge. Richesse quand, après la télécommande zapeuse, les recherche développées pour la commande vocale des aides techniques pour grands handicapés appuient la mise au point de la reconnaissance vocale informatique. Richesse quand le sourire du "débile" vient éclairer une réalité dramatisée. Richesse encore quand la personne mutilée "...fait prendre conscience des limites de la jouissance, de la perfection du bien être" (6) .
Richesse économique enfin, quand on mesure la masse monétaire mise à disposition du handicap et le nombre de personnes que cet argent fait vivre et travailler (médecins et para médicaux, éducateurs, directeurs, fabricants et commerçants spécialisés...).
Comme me l'avait très justement fait remarquer un homologue québécois, "Nous sommes une des plus riches matière première du pays".
 Index
des publications
Index
des publications